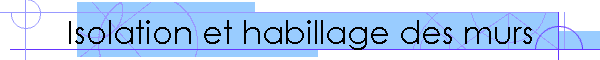Dans une ferme du début du siècle,
les murs sont en moellon assemblés avec de la terre. Cela
donne une bonne isolation thermique, mais on ne peut pas laisser
les murs en l'état :
- D'abord, les murs produisent une
masse de poussière importante,
- Ils ne sont que
moyennement isolants (voir Calculs
thermiques),
- Et l'inertie thermique est énorme :
Ne pas compter faire monter une pièce à température
en moins d'une demi-journée. Puisque nous ne voulons pas
maintenir les pièces à température constante
(voir modes de chauffage), il était
essentiel de baisser cette inertie.
Les impératifs sont différents selon que le mur est en contact avec l'extérieur (mur froid), ou que le mur est une séparation intérieur (séparation de corps de bâtiments). Un mur froid de grande surface doit présenter une forte isolation. Une séparation intérieure supporte d'être moins isolée. Pour elle, il faudra surtout empêcher la poussière en gardant une bonne esthétique.
J'ai utilisé plusieurs techniques :
Plaques de plâtre sur rails métalliques
Une armature constituée de profils
métalliques permet de bloquer un isolant à distance
du mur. Puis on visse du plaques de plâtre sur la structure.
- Deux épaisseurs de profil (et d'isolant) disponibles
: 5 cm et 7 cm, selon le coefficient d'isolation désirée.
- Avantages :
- bonne isolation,
- solidité,
- permet de rectifier la
géométrie du mur.
- Inconvénients :
- coût un peu élevé,
-
encombrement (au moins 10 cm d'épaisseur)
- pose longue.
Pose des rails
- Des rails en forme de U sont fixés au sol et au plafond, en laissant une lame d'air de 5 cm avec le mur. Pour la fixation du rail sur des poutres (sur la charpente du toit...), il existe tout un assortiment de pattes permettant un alignement parfait et un montage souple (pour éviter que le travail de la charpente ne fende le plâtre).
- D'autres rails, en forme de U (légèrement refermé en haut du U), sont disposés verticalement, chaque extrémité s'insérant dans les rails horizontaux. Les montants doivent être espacés de 60 cm (une plaque de plâtre faisant 120 cm de large). Les montants en milieu de mur sont composés de deux rails mis dos à dos.
- Les rails sont fixés entre eux par de petites vis spéciales, autoforantes : En théorie, il suffit d'une visseuse pour que la vis perce le métal. En pratique, la vis dérape, ou, si l'on fait une marque au poinçon pour éviter ce dérapage, la vis met 30 secondes à percer les deux épaisseurs de rail. Il est bien plus pratique de faire un pré-trou avec une mèche de 2,5 mm monté sur une perceuse (et garder la visseuse pour la pose de la vis).
- Il est aussi possible de bloquer les rails entre eux à l'aide d'une pince spéciale qui effectue une sorte de gaufrage qui fait office d'assemblage (on doit pouvoir la louer). Je n'ai pas essayé cette technique, et ne peut donc émettre de jugement. Si quelqu'un peut me communiquer son expérience...
Pose de l'isolant
L'isolant se présente sous forme de panneaux de laine de roche ou de verre, avec du papier kraft pare-vapeur sur une face (dimension 60 x 135 cm). Les panneaux s'inserent et se bloquent sur la partie refermée du U. Aucune autre fixation nécessaire.
Pose des plaques
Les plaques de BA13 (dispo en 120x240, 120x260 et 60x240) sont vissée avec des "vis à plaques" (vis très effilée au bout, et avec une tête en trompette qui entre dans la plaque sans la fendre) sur les rails. Prévoir une vis tous les 30 cm. Les vis posées en milieu de panneau doivent pénétrer de 3 mm environ. Ne pas compter sur le réglage de couple d'une visseuse pour obtenir ce léger enfoncement, puisque le bois n'est pas de densité égale à tous endroits. Il faut donc soit investir dans de l'outillage pro, soit accepter de faire le dernier tour à la main....
Les plaques de plâtre sont très simple à couper : un trait de cutter sur le carton de la face visible, et on casse en pliant vers la face arrière. Couper après le carton sur l'autre face.
Pour une salle de bain, utiliser des plaques hydrofugées (vertes).
Pour la finition, voir ici...
Plaques de plâtre doublées polystyrène
Solution plus simple et moins chère
que la pose sur rails.
L'isolant est ici du polystyrène
expansé, d'une épaisseur de 2 à 8 cm. On
trouve des plaques de BA10 avec le polystyrène déjà
collé dessus. Je n'ai pas trouvé de version
hydrofugée, et dans ce cas j'ai collé moi-même
le polystyrène sur la plaque.
La découpe des
plaques doublées est plus compliquée (avec de fortes
épaisseurs, on ne peut pas plier la plaque). J'ai essayé
une coupe du papier sur les deux face, mais il arrive que l'on ne
soit pas juste en vis-à-vis. J'ai donc opté pour une
découpe à la meuleuse d'angle, avec un disque
diamant (plus fin, pour faire moins de poussière). Puis
j'ai trouvé que cela faisait décidément
beaucoup de bruit et de poussière, j'ai pris une égoïne
à matériaux (10€ dans les foires au bricolage
de Leclerc...)
Pose
Bien dépoussiérer les murs
(sinon, j'ai fait la connerie, ça ne colle pas !),
Si
le mur est irrégulier (pas en bonne ligne droite, ou pas
vertical (les vieux murs en moellons sont toujours plus minces en
haut) ), poser un tasseau de bois en haut du mur, avec des cales
si nécessaire pour rattraper l'alignement.
Poser des
plots de colle-spéciale-faite-pour-ça sur le
polystyrène.
Appliquer la plaque contre le mur.
Si
le mur est irrégulier (moellons), décoller la plaque
du mur. Vous voyez alors la marque des plots sur le mur. Appliquer
des plots de colle sur le mur, et on referme sans trop écraser.
Ce double encollage est légèrement plus long, mais
tellement plus sécurisant. Si votre plot sur la plaque
correspond à un joint terreux du mur, le collage ne se
serait pas fait, et une plaque mal collée est très
difficilement rattrapable. Si vous avez mis un tasseau en haut du
mur, vous pouvez maintenant visser la plaque sur le
tasseau.
Utiliser une règle de maçon (3 mètres,
c'est le mieux), pour écraser plus les plots en mettant
toutes les plaques en ligne, tout en vérifiant la
verticalité.
Si vous n'arrivez pas, malgré la
règle, à faire que les joints restent au même
niveau, vous pouvez visser un bout de tasseau derrière la
plaque posée, puis derrière la plaque appliquée.
Il vaut mieux enlever le polystyrène à cet endroit.
Voir le schéma sur la page joindre
des plaques par les bouts non amincis.
Si vous comptez passer des câbles et
autres tuyaux derrière une plinthe, deux solutions :
utiliser des cales pour surélever les plaques lors de la
pose, soit une découpe après séchage, à
la meuleuse d'angle (pas pratique dans les coins).
Murs rejointoyés
Avantage : esthétisme.
Inconvénients :
- très long (3 heures
par m²),
- les pierres doivent être belles (pas
trop petites...),
- isolation nulle,
- assombrit la pièce.
J'ai utilisé cette solution que pour de petites
surfaces : embrasures de portes et fenêtres, petites surface
au dessus du plan de travail de la cuisine...
Pour la technique, voir rejointoyer
Murs replâtrés
Plâtrage fin sur des moellons
Une fine couche de plâtre est appliquée sur les pierres. On projette avec une truelle un peu de plâtre, puis on étale. J'ai pour cela d'abord utilisé une éponge, puis j'ai trouvé qu'une grosse brosse à encoller le papier peint était bien plus rapide. Si possible lisser pendant que le plâtre durcit, sinon on peut mettre une couche d'enduit de rebouchage ensuite. Un coup de peinture, et hop !
Avantages :
- effectue le rebouchage des
trous dans la même passe.
- assez rapide,
- laisse
voir le contour des pierres,
- bloque la poussière.
Inconvénients :
- isolation
thermique quasi-nulle (comme déjà dit plus haut, un
mur en moellon est moyennement isolant, et surtout présente
une inertie thermique terrible).
- ne supporte pas trop
l'humidité excessive (auréoles sur la peinture),
mais laisse grandement respirer le mur.
J'ai utilisé cette solution pour le
mur de séparation du salon, le couloir de la porcherie (mur
extérieur "froid", mais quand même au sud),
dans mon atelier....
Plâtrage "épais"
Le plâtre recouvre ici entièrement le mur et rattrape tous les défauts. Sur un mur extérieur de moellons, il faut isoler le plâtre de l'humidité du mur. On monte donc devant le mur une cloison de briques plâtrières (présentant un relief permettant au plâtre de s'accrocher), en ménageant un vide sanitaire.
Avantages :
- c'est la finition
traditionnelle, c'est du solide.
- les chevilles tiennent bien
dans la briques
Inconvénients :
- on perd pas mal
de place (autant qu'avec les rails),
- faible isolation (sauf
si on est prêt a perdre encore plus de place),
- la
réalisation est très difficile, pas à la
portée de l'amateur,
- donc, c'est cher.
Je n'ai pas utilisé cette solution.
Murs chaulés
J'étais très content de ma
solution du plâtrage fin quand un jour j'ai eu l'occasion de
faire un essai de chaulage sur un mur qui devra finalement
disparaître derrière du placo (voir au chapitre
"Joints" de la page "Murs").
Donc, avant de
chauler un mur, il faut refaire les joints par trop abîmés.
Ceci dit, le jointoiement de doit pas forcement être
parfait, car la couche finale est capable de remplir des fentes ou
trous de quelques 5 mm.
Donc un fois le mur préparé,
on applique un lait de chaux. Je le prépare d'une
consistance à peine pâteuse, c'est à dire que
lorsque j'y trempe une truelle et la ressort verticalement, le
lait s'écoule en laissant une pellicule blanchâtre.
On peut utiliser de la chaux hydraulique (qui nécessite de
l'humidité pour durcir), ou de la chaux aérienne
(qui elle a besoin du gaz carbonique).
La chaux hydraulique
durcit plus vite et présente une plus grande dureté,
mais peut poser problème par temps trop chaud.
La chaux
aérienne est plus souple, donc se fendille moins sur de
vieux murs qui travaillent, mais l'application est risqué
si il pleut dans les 24 heures...
J'ai donc opté pour un
joyeux mélange des deux, avec l'inconvénient que ma
chaux aérienne est d'une couleur légèrement
moins blanche, donc on peut voir que je n'ai pas respecté
les mêmes proportions partout...
On peut l'appliquer avec un gros pinceau,
mais c'est assez fastidieux, et cela goutte facilement; Après
plusieurs essais, j'ai trouvé l'engin idéal: le
graisseur.
C'est en fait une sorte de pistolet à
peinture, mais normalement prévu pour asperger de graisse
les engins agricoles. En tout cas, cela se bouche bien moins
facilement qu'un pistolet normal. Plus que l'éjection du
produit, c'est en fait l'entrée d'air dans le pot qui pose
problème, la lumière se colmatant tout le temps.
Plusieurs solutions:
- Soit boucher la sortie du pistolet avec
le doigt et donner un léger coup de gâchette: l'air
sous pression entre alors dans le pot et ressort par la lumière
bouchée.
- Soit ne pas serrer entièrement le pot,
et secouer de temps en temps
- Soit on en a marre de remplir
précautionneusement avec un entonnoir ce pot qui décidément
ne contient pas grand-chose, et on le remplace par une vieille
gamelle en alu, ou un bocal à cornichons. Ca se remplit en
un clin d'oeil, et pas de problème d'entrée d'air...
Seul inconvénient: cela occupe les deux mains. J'ai ainsi
reblanchi 50 m² en une demi-journée. Je procède
en deux passes. La première est suivie d'un coup de pinceau
qui permet de mieux reboucher les trous, la deuxième sert
surtout à se dire que l'on a passé assez de temps à
mettre les échafaudages, vaut mieux mettre la dose dès
maintenant.