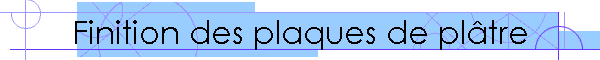
(attention: "Placoplâtre" est une marque protégée, ainsi que "Placo" : je me dois d'utiliser le nom générique "plaque de plâtre", abrégé en PDP dans ce site, sinon je suis attaqué par leurs juristes, et de plus j'ai l'air aussi ringard que ceux qui parlent de "frigidaire" ou de "mobylette")
Une fois les PDP fixées au plafond, au mur ou à la cloison, il vous reste à faire disparaître les séparations entre les différentes plaques.
Les plaques sont plus minces sur les cotés,
pour pouvoir masquer les joints (minute pédagogique: la
plaque la plus courante s'appelle BA13, pour Bords Amincis, 13mm.
Mais il existe aussi des plaques avec des bords arrondis, qui
restent esthétiques sans joints; je l'ai vu souvent aux
Pays-Bas).
Le principal problème est qu'une PDP
présente une surface parfaite, plane comme un miroir. Donc
le joint doit être aussi parfait si on ne veut pas qu'il se
voie comme le nez au milieu de la figure. De plus, j'utilise
beaucoup les appliques et autres éclairages indirects ou
rasants, qui font ressortir tous les défauts...
Deux solutions s'offrent à vous :
la solution parfaite, et la solution du défaut généralisé.
Après, nous verrons les
possibilités de revêtements finaux.
La solution parfaite :
Je vais d'abord décrire les étapes telles que vous les ferez pendant votre mise en jambes. Une fois habitué à ne pas travailler comme un cochon, les étapes de ponçages et de durcissement vont se réduire, et donc la rapidité d'exécution se trouvera grandement augmentée.
Remplir les éventuels jours entre les PDP avec de l'enduit de rebouchage,
Poser une bande de joint entre les plaques : il existe deux modèles :
En papier cartonné (se colle sur l'enduit frais posé à l'étape précédente),
En fibre de verre autocollante (bien plus chère, mais plus solide et plus facile de pose : en fait, on pose la bande en premier, puis on recouvre largement d'enduit; la fibre étant ajourée, l'enduit passe à travers pour boucher les jours).
Préparer de l'enduit de rebouchage juste assez pâteux pour éviter qu'il ne coule.
Il est essentiel d'utiliser ici un couteau au moins 1,5 fois plus large que le creux.
La dernière passe du couteau doit être faite avec la lame presque perpendiculaire au mur, sans trop appuyer, pour éviter que la lame ne se courbe sous la pression, ce qui provoque un creux sur une grande longueur. L'enduit a alors tendance à ne pas être bien lisse (micro-vaguelettes, craquelures), mais ne pas trop tenter de rattraper maintenant ce défaut.
A ce moment provoquer de légers trous (moins de 5 cm de diamètre) n'est pas grave. Votre seul objectif doit être : ne provoquer aucune bosse (très difficile à poncer).
C'est bon pour aujourd'hui, vous pouvez aller vous coucher.
Une fois l'enduit bien sec, passer une cale à poncer (au moins aussi large que le couteau). A aucun moment il ne faut que l'une des extrémités de la cale ne quitte le contact du papier qui recouvre le plâtre : ce papier est le guide qui vous évite de faire des creux. Si vous avez bien travaillé lors de la pose d'enduit, cette étape de ponçage est juste une formalité, une vérification que vous n'avez fait aucune bosse au-dessus de la zone non amincie. En quelques coups, on doit retrouver la couleur du carton sur toute la surface hors de la zone amincie, et donc votre guide est prêt pour la passe suivante.
Enlever la poussière avec une balayette, sinon la couche suivante ne va pas adhérer !
En séchant l'enduit a pu se rétracter (au niveau des jours entres plaques). On repasse donc une couche d'enduit, plus liquide cette fois. La géométrie du joint étant satisfaisante à grande échelle, on peut maintenant maintenir la lame presque parallèle au mur: on lisse l'enduit sans risquer de déformation du couteau.
Attendre de nouveau le séchage, puis contrôler votre travail avec la lumière rasante. Si c'est pas bon : ponçage, dépoussiérage, enduit...
Travailler avec les couteaux:
J'ai
parlé ici d'utiliser un couteau à enduire. Il s'agit
une plaque d'inox ou de fer, avec un manche dans le même
plan que la plaque. Les pros préfèrent le fer (plus
souple), les amateurs préfèrent l'inox (ne rouille
pas pendant les périodes de non-utilisation). On appelle
cela aussi (improprement?) une spatule.
- Dans tous les travaux à la spatule, il faut systématiquement travailler avec une spatule dans chaque main. La plus petite spatule sert à puiser la pâte dans son récipient, puis à reporter celle-ci au centre de la lame qui va appliquer sur le mur. Si l'on puise directement avec la lame d'application, la pâte proche des extrémités contourne la lame et fait un bourrelet qu'il faut écraser par une seconde passe chevauchante, qui vient détruire le boulot fait précédemment. Ceci est vrai pour l'enduction des joints, où l'on a pris soin de prendre une spatule plus large que la surface à enduire, mais aussi pour l'enduction de surface plus larges; dès que le phénomène apparaît, on recentre la pâte avec la deuxième spatule.
- Dès que la spatule d'application commence à se charger de pâte qui a rendu son eau au support, et qui est beaucoup moins plastique, on la remet dans l'auge (avec la petite spatule de la main gauche...) où elle aura le temps de se "regonfler", et on repart avec de la pâte neuve.
- La spatule d'application doit toujours s'appuyer sur une surface de référence dure, de chaque coté de la lame. Si un des angles de la spatule passe sur de l'enduit frais, il laissera une marque. Si les deux cotés de votre lame, a un moment donné, ne touchent pas du carton, alors vous êtes obligatoirement en train de faire une bosse ou un creux. Il faut donc une lame LARGE.
- Il est primordial d'avoir l'auge à bonne hauteur (sur un tabouret...), afin de ne pas trop avoir à se baisser, sinon on a forcément tendance à trop prélever de plâtre à chaque fois, ce qui finit toujours (surtout quand on travaille au plafond) par de belles bouses au sol, sur les pieds, les bras, et la tête, alouette.
Précisions
Maintenant, je vais insister, car j'ai beaucoup de mails à ce sujet:
Il vaut mieux faire plusieurs passes fines et rapides, avec durcissement intermédiaire, qu'une seule passe épaisse. De toutes manières, l'enduit a tendance à se rétracter en séchant, il apparaît donc un creux au niveau de la jonction des plaques (là où la couche est la plus épaisse). C'est donc une perte de temps que d'essayer de faire une passe épaisse parfaite.
L'enduit de rebouchage durcit en une heure, on peut donc faire une pièce en passant rapidement d'un joint à l'autre, et on fait la passe suivante quand on a fini le tour. Si l'on a bien travaillé en évitant les bourrelets comme décrit ci-dessus, pas besoin de ponçage intermédiaire. On ne fera le ponçage que juste avant peinture.
Plus l'enduit est liquide, plus il est facile à appliquer, plus il se lisse facilement. Il faut donc que, lorsqu'on trempe le couteau dans le bac d'enduit et qu'on le ressort verticalement, l'enduit s'écoule en laissant qu'une pellicule de quelques millimètres sur la lame. Le fait qu'il soit liquide au départ ne change en rien son temps de durcissement (mais augmente le retrait). En fait; on fait la première passe avec de l'enduit plus épais surtout pour pouvoir en mettre une plus grande quantité sur la lame, et pour que les bandes cartonnées soient bien engluée (ne bougent pas) en attendant que cela durcisse. La viscosité de cette première passe est légèrement supérieure à celle de la crème Mont-Blanc: lorsqu'on touille, la surface de l'enduit revient presque plane, les gros trous se comblant tous seuls avec la gravité, seules subsistent des vagues de 1 ou 2 cm de hauteur.
Si malgré tout un ponçage est nécessaire, il faut alors attendre un séchage plus complet, sinon le papier de verre se bourre. Pas la peine d'appuyer comme un sourd, au risque d'arracher le carton. N'utilisez pas de ponceuse vibrante, vous ferez des creux. Dans mes premiers essais, j'ai passé des heures à la vibrante avec un grain fin afin d'effacer les rayures, sans me rendre compte que je creusais le joint. Donc que cela servait à rien. Si votre passe laisse les bords d'appui propres, et que la lame repose bien sur ces bords, pas de ponçage, même si cela paraît bourré de défauts. Ceux-ci seront traités bien plus facilement au tour suivant.
Eviter "l'enduit pour plaque de plâtre" lors des passes de remplissage, celui-ci est bien trop liquide. On prend de l'enduit de rebouchage. L'enduit pour plaque de plâtre ne sert que pour la dernière passe de finition. Cet enduit cède très peu de son eau au support, il reste donc plastique assez longtemps pour être bien lissé, ce qui n'est pas le cas de l'enduit de rebouchage.
Angles entrants
Pour les angles entrants, utiliser une
spatule spéciale (la lame est une tôle pliée
formant un angle de 90°); Il ne faut jamais poser cette
spatule à plat dans l'angle, mais l'incliner pour que seul
ses tranchants touchent la plaque, sinon cela provoque des
traînées. On peut aussi utiliser préalablement
la bande armée pour éviter les fissures (voir
ci-dessous)
Angles sortants
Pour les angles sortants (arêtes),
trois solutions :
- La bande armée : c'est une bande de
papier cartonné dans laquelle sont noyées deux fines
lames métalliques. La bande se plie entre ces deux lames
selon un angle quelconque, avec une bonne linéarité.
Attention, cette bande ne se trouve pas partout... Voir comment
faire ci-dessous.
- La baguette plastique qui forme l'arête
(je n'ai pas utilisé, je ne peux pas trop en parler),
-
Recouvrir l'angle avec une baguette en bois profilée en
cornière. Cette baguette peut alors se vernir ou se
peindre, selon l'effet désiré. C'est la solution la
plus rapide, car il n'y a aucun enduit à faire (s'il n'y a
pas de bord aminci en arête). Un peu de colle Néoprène,
et hop!
Angles sortants avec bande armée:
si
vous avez disposé les bords amincis en arête:
- vous appliquez une fine couche d'enduit de rebouchage bien
pâteux (colle mieux que l'enduit de finition pour
plaques),
- pré-pliez la bande pour que,
relachée, elle ait le bon angle (évite les problèmes
d'élasticité du papier)
- appliquez
la bande sur l'enduit frais (donc la bande est collée par
l'enduit)
- remettre une couche d'enduit
par-dessus. Comme toujours, le but est de combler grossièrement
les creux, avec comme impératif de surtout ne pas faire de
bosses.
- attendre que ça durcisse
- découper les bavures qui se forment inévitablement
au niveau de l'arête, avec un large couteau à enduire
bien appliqué sur les faces de références
- re-enduit, re-durcissement, re-découpage des bavures (à
faire deux ou trois fois jusqu'à ce que cela soit
satisfaisant)
- c'est assez difficile d'obtenir une arête
propre si on cherche à enduire des deux cotés de
l'angle à la fois. Il vaut mieux enduire d'un coté,
en formant intentionnellement un bourrelet de l'autre coté.
Puis on découpe l'excédent du bourrelet légèrement
durci, avec des petits mouvements circulaires de la spatule
utilisée à rebrousse-poils, mais surtout bien guidée
par le plan de référence de la partie non amincie.
si l'arête n'a pas de bord
aminci:
- coller la bande avec de la colle à
bois (cela limite les sur-épaisseurs)
- enduire
au-dessus de la bande comme dans le cas du bord aminci. La
sur-épaisseur est masquée par une bande relativement
large d'enduit (au moins 10 cm).
Tout enduire
Si on veut être perfectionniste, mais
c'est en fait c'est assez rapide, on peut, après le
rebouchage décrit ci-dessus, enduire entièrement la
plaque avec l'enduit de finition. Pour certaines peintures assez
lisses (appliquées au rouleau à poils courts), cela
permet d'éviter de légers changements de granularité
de surface (entre le papier et l'enduit) qui apparaissent surtout
comme des nuances de couleur, et qui sont difficiles à
rattraper. L'outil utilisé ici est une lame de 50 cm de
large, avec une barre-poignée parallèle à la
lame, ce qui permet de la manipuler à deux mains, ce qui
est bien pratique, car il faut appuyer fortement.
On peut aussi
utiliser un platoir. Il s'agit d'une plaque en inox (12 cm x 30 cm
environ), tranchante sur chacune des arêtes, et avec le
manche fixé perpendiculairement au milieu de la plaque.
Cela donne un meilleur résultat, plus facilement, quand il
s'agit d'appliquer une couche épaisse toute la surface de
la plaque. On l'utilise surtout pour appliquer du crépi, ou
du plâtre sur une surface trop irrégulière
pour servir de guide de planéité (parpaings...).
La solution du défaut généralisé :
Il s'agit ici de transformer les défauts en texture généralisée sur l'ensemble des panneaux. Les joints, même imparfaits, ne se voient plus !
|
|
Reprendre les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus. Les joints sont alors bouchés, sans finition. |
|
|
Prendre une éponge de maçon (structure fine), et étaler irrégulièrement de l'enduit de rebouchage sur toute la surface du mur. |
|
|
Attendre un peu que cela sèche, et repasser l'éponge humide pour lisser les marques d'éponge. |
On obtient ainsi une finition qui
s'apparente aux murs à la chaux que l'on peut voir dans les
pays méditerranéens. J'ai utilisé cette
solution dans un petit couloir comprenant de nombreux angles (les
arêtes bien droites sont assez délicates), et au
plafond irrégulier (les plaques de plâtre s'étant
incurvées sous leur poids, les supports étants trop
distants).
Je cite ici un retour d'expérience d'un lecteur:
"En commentaire à votre
paragraphe sur le "défaut généralisé",
j'ai réalisé un enduit dans une cuisine pour un
effet "à l'ancienne":
J' ai teinté
l'enduit dans la masse avec un pigment en poudre, appliqué
à la spatule en laissant une légère texture.
Après durcissement, j'ai repassé une spatule pour
écraser les reliefs trop importants, inutile de vouloir
trop en faire, car la couleur un peu inégale renforce
l'effet de relief. Après séchage complet, j'ai passé
au spalter une cire incolore teintée des mêmes
pigments.
Le résultat est très satisfaisant et
n'a pas bougé depuis 3 ans, pour un prix de revient
dérisoire par rapport aux produits tout prêts. "
Revêtement final
Reste à protéger le mur, et à
lui donner éventuellement de la couleur.
- Carrelage
:
Le carrelage se colle très bien aux plaques de
plâtre. Je l'ai fait pour la partie basse risquant d'être
mouillée au-dessus de la baignoire (voir carrelage)
Dans les autres cas suivants, il faut mettre au rouleau une première couche de peinture acrylique, pour éviter que le carton ou l'enduit ne boive la colle ou la peinture. Les seaux de 15 litres à 40 francs dans les grandes surfaces conviennent très bien.
- Finition peinte : voir aussi à Peinture. Utiliser de la bonne peinture. A certains endroits, j'ai utilisé la même peinture acrylique bas de gamme, en me disant que cela ne me gênait pas si elle jaunissait un peu. Elle a effectivement jauni, ce qui m'empêche toute retouche (pas possible de retrouver la même couleur). Une peinture lessivable est aussi bien utile même dans les endroits peu salissables, lorsque de malencontreux chocs lors de manutentions laissent des marques. Attention de bien attendre que la dernière couche d'enduit soit bien dure et non juste sèche (voir les temps de durcissement sur l'emballage), sinon l'apport d'eau de la peinture re-dilue l'enduit, et, surtout lorsqu'on travaille au rouleau, l'enduit se décolle en plaques et se mélange à la peinture. Effet affreux garanti : j'ai du ainsi enlever la peinture fraîche, refaire l'enduit, etc...
- Papier peint : évidemment possible, mais je n'aime pas : pas fait, pas de commentaire...
- Fibre de verre à peindre: Comme le papier peint, mais présentant en relief un motif de tissage, et devant être peint après la pose. Permet de rattraper certaines horreurs qu'on a la flemme de rattraper à l'enduit, et d'obtenir une résistance maximale à l'apparition de fissures. Donc surtout utile lorsqu'on a une cloison mixant les matériaux (bois, plâtre, briques...)
- Le crépi d'intérieur:
J'ai longtemps cru que la seule différence entre un crépi
intérieur et un crépi extérieur était
son étanchéité. Et j'avais le souvenir des
crépis hyper-agressifs et nid à poussière du
style néo-breton. Mais en fait, le crépin intérieur
a un grain très fin, et il peut être lissé, ne
laissant apparaître sa nature sableuse qu'au touché
et aux légères différences de réflexion
de la lumière suivant le sens de la dernière passe
de lissage.
Je l'ai utilisé dans mon atelier,
directement après le rebouchage des gros trous, sur des
plaques ainsi que des carreaux de plâtre. J'ai ainsi
effectué en une seule passe l'équivalent du
rebouchage fin et de la peinture.
- Finitions "rustiques".
Les rayons Peinture sont maintenant "envahis" de
peintures spéciales à effets. Elles se présentent
le plus souvent en deux composants : une base qui donne la
structure (à étaler "au hasard" à
la spatule), et des pigments qui donnent la couleur, à
répartir non uniformément à l'éponge,
à la brosse. Tentant mais cher. Pas fait; si quelqu'un peut
faire des commentaires...
Il doit être aussi possible
d'obtenir un effet similaire à partir de ma "solution
du défaut généralisé", en fixant
par-dessus des pigments (ceux vendus chez les fournisseurs pour
arts plastiques sont sûrement moins chers que ceux
précédemment cités, vendus à prix
d'or).
Ceci dit, j'ai trouvé en solde une cire teintée,
et je l'ai appliqué sur les plaques de plâtre
recouvertes de crépi d'intérieur de mon atelier.
Mais le problème est que l'humidité du mur n'était
pas bien régulière (3 jours après le
rebouchage des joints, dans une pièce non chauffée),
et donc la cire a été moins bien absorbée au
niveau des joints (incompatibilité entre le gras et
l'humide). Il en est résulté des zones plus claires,
et c'est irrattrapable. Ne faites pas la même erreur!