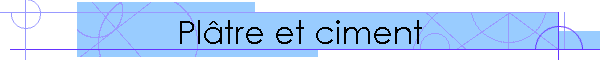L'âme de la rénovation, le
"vrai" travail, par rapport au bricolage des autres
métiers...
Plâtre et ciment ont ceci de commun
que ce sont des poudres qui durcissent par hydrolyse: alors que
pour la plupart des colles et peintures, le catalyseur est
l'oxygène, c'est ici l'eau qui rentre en réaction
chimique pour lier les molécules entre elles et solidifier
ainsi la pâte. Ils peuvent ainsi durcir même
complètement sous l'eau. Même, il faut veiller qu'il
y ait assez d'humidité pour que la réaction puisse
se faire : on doit abriter un ciment d'un trop fort soleil, et
arroser régulièrement en cas de risques
d'évaporation trop rapide.
Attention : plâtre et
ciment sont des frères presque ennemis : si le plâtre
adore le ciment, celui-ci ne le lui rend pas: quelques traces de
plâtre, et le ciment ne prendra pas : ne pas mélanger
les outils pour les deux matériaux! Nettoyer les traces de
plâtre sur les surfaces destinées à recevoir
du ciment !
Ciments
Attention, l'acidité du ciment attaque la peau: mettre systématiquement des gants étanches ! Seuls les vieux maçons avec une peau de crocodile peuvent s'en passer. Mais ils risquent quand même à terme de développer une allergie.
Types de ciments
Il existe différents ciments, suivant leurs caractéristiques, et donc l'usage que l'on doit en faire :
- Portland : c'est le passe-partout, celui
qui sert pour la maçonnerie générale (mur,
dalles, ...), prend en quelques heures (dépend surtout de
la température), met environ une journée pour être
dur (on peut marcher délicatement dessus), mais atteint sa
résistance nominale au bout d'une semaine (ne pas enlever
les étais trop vite !). Coût : environ 1 fr/kg
-
Prompt : ciment à prise rapide (10 minutes environ).
Meilleure résistance, mais au moins dix fois plus cher.
Utilisé pour les scellement des pattes d'une huisserie, des
gonds de portail...
- Ciment fondu : ciment de plus grande
résistance thermique, pour les maçonneries de
cheminées. Utilisé aussi mélangé au
Portland: améliore le liant, augmente la résistance
mécanique et accélère la prise. Ce mélange
est utilisé comme enduit et pour les surfaces laissées
brutes (exemple: marches extérieures).
-
JMeRappellePlusLeNom (en fait dépend des marques): ciment
contenant des additifs limitant le retrait et augmentant
l'adhérence pour effectuer les solins (liaison
pierre-toitures) et les enduits.
- Ciment blanc : pour obtenir
des couleurs précises (additionné de pigments).
Additifs :
Un ciment ne s'utilise jamais pur (à
part des fois le prompt).
- Charges : sables et graviers:
Augmente le volume à coût moindre, et limite le
retrait. La granularité est un compromis entre l'épaisseur
d'application en le lissé de surface désiré;
Avec uniquement du sable, on obtient du mortier
pour les faibles épaisseur; le mélange
sable-gravier (béton)
permet de plus grosse épaisseur en limitant mieux le
retrait. Attention alors : il doit y avoir assez de sable pour
combler les espaces entre les cailloux, sinon la résistance
baisse dramatiquement. J'utilise la règle 1-2-3 : un seau
de ciment, 2 seaux de sable, 3 seaux de gravier.
- Armatures :
Pour augmenter la résistance mécanique et éviter
les risques de fissuration. Principalement tiges de fer, souvent
soudées entre elles en grillages ou diverses formes en
trois dimensions. Mais peut être aussi de la fibre de verre
dans certaines conditions pas trop exigeantes.
- Chaux : sert
d'anti-mousse (mais pas très efficace), rend étanche
à l'eau liquide tout en laissant la vapeur d'eau s'échapper
(un gore-tex préhistorique !)
- Ralentisseur : pour
éviter une prise trop rapide (voir dalles
béton ).
- Plastifiant : pour augmenter l'adhérence
à un autre support, et pour rendre étanche (solins,
sanitaires, piscines, réservoirs...),
- Pigments : pour
colorer dans la masse
Préparation :
Il faut toujours mélanger les divers
ingrédients entre eux à sec, avant d'ajouter l'eau.
Le dosage de l'eau est toujours très critique, et dépend
de l'utilisation. J'indiquerai dans chaque chapitre la consistance
à obtenir.
Voici les différents moyens de se
procurer ou réaliser soi-même du béton ou du
mortier.
Livraison: Il
faut toujours y songer dès que l'on dépasse 1 m3: La
livraison n'est pas si chère comparé au fait de se
faire livrer les ingrédients, et la qualité finale
et bien meilleure (voir dalle ).
Votre dos vous dira merci... Le prix de la livraison dépendra
fortement du type de déchargement offert par
camion-toupie:
- le camion de base dispose d'une gouttière,
qui permet de disposer le béton au sol jusqu'à
environ 5 mètres du cul du camion, en passant
éventuellement par une fenêtre ou une porte
- La
camion avec tapis roulant peut faire monter le béton ou le
disposer beaucoup plus loin, mais c'est aussi beaucoup plus cher.
Bétonnière : Je met toujours le gravier en premier, principalement pour décoller des restes de la fournée précédente, puis le sable, puis le ciment. Ne pas brasser trop longtemps à sec, car le mélange finit par faire bloc.
Auge à ciment : A ne réserver que pour les très petites quantités, tant il est difficile d'avoir un mélange homogène dès que l'on dépasse le tiers de la contenance.
Pelle : J'ai eu un maçon qui
ne voulait pas entendre parler de bétonnière. Je
n'ai pas bien compris ses arguments, mais c'est vrai qu'il
arrivait à faire rapidement de grosse quantité. La
méthode est la suivante : sur une large surface libre (le
mieux est une dalle de béton, mais on peut aussi prendre
une plaque de contreplaqué), on dispose le sable en un beau
tas conique. On verse le ciment dessus. On plante la pelle pour
prendre un peu des deux ingrédients, et on verse en pluie,
pour reformer un cône juste à coté du premier
tas. On "déplace" ainsi le tas 2 fois. Avec la
pointe de la pelle, on écarte la base du cône pour
faire une "ceinture corallienne" au "volcan",
La ceinture doit faire environ 7cm de haut, pas plus. On verse de
l'eau entre la ceinture et le volcan: voila le lagon! Puis on fait
effondrer un peu de la montagne dans le lagon, et on surélève
la ceinture. Le lagon s'est donc déplacé vers le
centre. On recommence ainsi jusqu'à avoir mouillé
l'ensemble du mélange. On re-déplace encore deux
fois le tas pour être homogène, et ouf, c'est enfin
prêt. Avec un peu d'habitude, je mettais 10 min pour faire
ainsi une brouetté de sable (12 pelletés pleines)
avec 20-25 kg de ciment ("colle" pour les murs). A faire
en hiver : ça réchauffe!
Remarque : une pelle de
maçon est plus petite que celle "classique" de
terrassier. Et je ne sait pas pourquoi, c'est vachement plus
facile, ça n'a rien à voir avec prendre des demi
pelletées ! Il peut être aussi très pratique
d'acquérir une "gratte", sorte de balai où
on aurai remplacé les poils par une lame métallique:
permet de nettoyer et regrouper les restes de ciments que l'on ne
peut prendre la pelle.
Se livrer soi-même: C'est une
solution que je n'ai considéré que beaucoup trop
tard. Une remorque non freinée standard supporte 500 kg de
charge utile, donc 1/4 de mètre cube de béton. Donc
pour les quantités pas trop grosses, il vaut mieux aller se
chercher directement son béton à la centrale, plutôt
que d'acheter les constituants séparément. On peut
donc se passer d'acheter une bétonnière (moi, de
toute manière, je l'empruntais à mon comité
d'entreprise), surtout si on ne sait pas où la ranger.
Seul
inconvénient: les horaires d'ouverture de la centrale à
béton.
MAJ 2010: j'ai fait un tour
récemment à la centrale à béton, avec
ma remorque; Refus du gus; même pas autorisé de
mettre 1/4 de mètre-cube là-dedans; les flics en ont
arrêté plusieurs en surcharge (densité béton
> 2400/m3, 1/4m3 > 650 kg), et le gus risque sa place. 'Faut
donc louer une remorque freinée, ou un petit camion à
plateau. Ils en louent par exemple chez Super U. Bon, on peut pas
dépasser 1/2 mètre-cube, mais ça le fait.
Plâtre
Au début, le plâtre me faisait
assez peur, il y a en effet une espèce d'aura autour du
plâtrier, et c'est vrai que recouvrir une cloison de brique
d'une surface absolument plane de plâtre demande peut-être
plusieurs mois de formation continue. Car cela implique le
maniement de plusieurs centaines de kg en un temps raisonnable.
Mais le plâtre peut être utilisé en couches
plus fines, et il devient alors à la portée de
l'amateur.
Dans mes premières réalisations, j'ai
tout fait pour obtenir un fini ni lisse ni plan (solution du
défaut généralisé : finition
structurée à la spatule, à l'éponge ou
au pinceau). Puis, en connaissant mieux, je m'attelle au presque
parfait (pour les plafonds)...
Le plâtre n'attaque pas
la peau, et le travailler à pleine main est des fois plus
facile, et représente une certaine joie puérile,
comme patauger dans la boue...
Types de plâtres
- Le plâtre "manuel"
standard (Targa ou Cercle Rouge) coûte environ 1frs/kg, et
durcit en environ 20mn. Il est assez grossier, et doit être
appliqué en couches supérieures à 1 cm sur un
revêtement absorbant (plâtre sec...). Il peut par
contre être mis en couches plus fines sur de la pierre par
exemple.
- Le plâtre pour machine : je l'ai découvert
par accident, mais ce plâtre destiné pour les
machines à projeter professionnelles possède un
énorme avantage pour les amateurs : il durcit en 2-3
heures! Pour s'habituer à un nouveau geste, quand on ne
sait pas combien de temps on va faire le travail, il est quasi
primordial de ne pas se sentir pressé par le temps. Je me
suis trop souvent trouvé avec une gâchée en
train de prendre! Surtout ne pas rajouter d'eau alors ! le plâtre
durcira plus jamais! Se hâter plutôt de tout bazarder
et nettoyer tous les outils: entre le moment où l'on
détecte le début de la prise et le bloc de pierre,
il n'y a que quelques minutes...
- L'enduit de rebouchage : en
fait, je ne sait pas si il y a du plâtre dedans, mais
il rend beaucoup moins son eau, et permet des applications plus
fines sans s'écailler.
- L'enduit de finition : c'est
presque une peinture, et dégouline si l'épaisseur
dépasse quelques millimètres. Mais il peut être
lissé et re-lissé.
Les outils
Auge : une en plastique suffit
largement. je réserve celle en caoutchouc pour le ciment.
Truelle : j'en ai plus d'une dizaine, mais j'utilise
toujours la même : elle est de forme ovoïde, et d'une
surface proche de celle de ma main. Je l'ai trouvé dans la
maison, mais curieusement, je n'en ai jamais vu de semblable en
magasin ! Les autres sont nulles : celles qui ont des angles vifs
laissent des marques, ou s'accrochent dans l'auge. Une taille
(surface) de lame bien adaptée à son physique est
très importante pour mélanger efficacement sans
fatiguer le bras ni le poignet.
Couteaux et lames :
rien à voir avec un couteau de cuisine ! En fait une plaque
d'inox prolongée par un manche. N'est presque jamais trop
large ! Je me suis attaqué aux finis lisses qu'après
avoir acquis une lame de 50 cm dans une foire aux puces...
Platoir : plaque d'inox aiguisée sur les bords,
avec un manche qui part perpendiculairement du centre de la
plaque. Surtout utile pour appliquer le plâtre au plafond,
et pour lisser (plutôt grossièrement).
Il existe aussi le même genre d'outil avec une éponge
collé sur la plaque. En fait ne sert pas à
grand-chose, ne lisse pas si bien... peut-être pour
humidifier le mur ? Mais un pulvérisateur fait mieux !
Sableuse : euh... c'était un essai plutôt
désastreux. J'me suis dit que pour faire le plafond, il
serai plus facile de projeter le plâtre. Puisqu'une
projeteuse coûte plusieurs dizaines de milliers de francs,
je pensait que cela serait possible d'utiliser un pistolet de
sablage acheté 80 Frs dans un de ces camions qui vendent de
l'outillage sur la place du village... Mais cela crache quasiment
rien, même en mettant le plâtre au dessus du pistolet,
dans un entonnoir. Que dalle. Cela blanchit à peine le mur.
J'ai essayé ensuite avec du sable, toujours aussi nul...
Peut-être qu'avec une vraie sableuse?
Pinceau à
encoller le papier peint: Je l'utilise pour enduire les murs
de moellons, en laissant le relief des pierres apparent, mais
surtout pour nettoyer les outils: c'est plus rapide et cela ne se
bourre pas comme une éponge !
La pratique
La pratique des couteaux et platoirs n'a
rien de sorcier, je l'explique dans finition
des plaques de plâtre. Surtout ne pas oublier de
travailler avec un outil dans chaque main.
Par contre le
plâtre est moins évident au premier abord. Au départ,
pour qu'il colle, je croyais qu'il fallait qu'il soit très
épais. Mais alors, il colle tout autant à l'outil,
et la moitié s'arrache avec. En fait, j'ai compris le truc
plus tard, il faut du plâtre tout juste assez épais
pour qu'il ne reste qu'environ 1 cm sur la truelle quand on la
tient verticale, genre yaourt brassé (on ne doit jamais
appliquer plus de 2 cm d'un coup, et c'est quand même
possible avec du plâtre si liquide car la première
projection donne quasi-instantanément de son eau au
support, et s'épaissit).
Je remplis mon auge d'eau
(environ 1/3 du volume final), puis je jette en pluie le plâtre
dedans (le bol en plastique souple qui contient la semoule du
couscous en boite est idéal pour puiser dans le sac).
J'ajoute ainsi jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée,
quelques îlots sec apparaissants. Un coup de truelle très
énergique pour homogénéiser le tout (ne
dit-on pas "battre comme plâtre" ?), un rajout
intermédiaire éventuel de plâtre après
avoir testé la consistance, et c'est bon. Sur le sac, il
est écrit qu'il faut attendre 2 minutes avant de mélanger,
mais j'ai pas vraiment vu de différence si on ne respecte
pas ce temps de repos. Après ce premier mélange, il
ne faut plus trop remélanger, sous peine de perdre de la
capacité d'adhérence.
On nettoie la truelle sur
le bord de l'auge, et on la charge d'un peu de plâtre sur la
tranche, et on projette sur le mur : Sblortch! Et ça tient
!
Il y a plusieurs gestes possibles pour projeter. Le plâtre
doit quitter la truelle par le bord qui a été
chargé.
- Soit on tient la truelle horizontale, on la
rapproche du mur à vitesse moyenne, puis on la recule
sèchement : simple, mais on ne peut pas mettre beaucoup de
plâtre, et on contrôle mal la force d'impact.
- On
tient la truelle verticalement, parallèlement au mur. On la
rapproche du mur, à la vitesse désirée
d'impact. Arrivé tout près du mur, on retire la
truelle parallèlement au mur : la bouse continue tout
droit, impact contrôlé.
- Après, si on
veut pouvoir mettre plus de plâtre sur la truelle, il faut
un mouvement circulaire pour contrecarrer la gravité et
l'accélération, avant de terminer par le geste
d'effacement de la truelle ci avant... Bonne chance !
On
notera qu'après quelques essais, j'ai même réussi
à projeter au plafond : c'était entre deux poutres,
et je ne pouvais utiliser le platoir (procéder par très
petites quantité; Port du casque
bonnet obligatoire)
Bon, après avoir projeté, il faut lisser. Si on travaille en couche épaisse, il vaut mieux attendre que le plâtre soit un peu épaissi, juste avant la prise. Si vous voulez quelque chose d'absolument plan, il faut forcement un guide : des baguettes de bois fixées au mur, sur lesquelles viendra s'appliquer le couteau ou la règle. On retirera ensuite ces baguettes pour reboucher les trous... Il faut absolument faire plusieurs couches, les premiers lissages supprimant les quelques crêtes qui dépassent, c'est tout; Si on lisse de grosses quantités sur une couche fraîche épaisse, on arrache tout. La première couche doit être assez fine, puisqu'elle a plus de mal à s'accrocher au support que les suivantes.
Il faut finir sa gâchée bien
avant la prise, et rincer l'auge tout de suite (ne pas mélanger
du plâtre frais avec du vieux), puis on repart pour une
nouvelle gâchée.
Au départ, on maudit ce
plâtre qui durcit trop vite; Quand on a compris qu'il faut
travailler en passes successives, cela devient un avantage: On
balance la première couche à peu près
n'importe comment sur toute la surface, un coup de règle
pour vérifier que rien ne dépasse des guides, on
prépare la gâchée suivante et on peut
recouvrir la première couche déjà durcie. Le
plus gros boulot est alors de gâcher et projeter, pas de
temps perdu.
plafonds hourdis
Dans ma porcherie (enfin ex-porcherie...), l'étage a été réalisé en béton coulé sur hourdis (sorte de parpaing au profil spécial, simplement posé sur des poutrelles de béton armé). Les plafonds du rez-de-chaussée présentent donc une surface de parpaing plus ou moins plate. J'ai enduit d'une couche fine de plâtre à prise lente. J'applique le plâtre au platoir, plus ou moins grossièrement, puis je lisse avec la lame large de 50 cm. Seule la prise lente permet cette méthode, sinon on a toujours des problèmes quand une application fraîche vient à coté d'une autre durcie, surtout qu'ici je n'ai mis aucun guide, et que la surface plus ou moins plane est obtenue par répartition approximative sur toute la surface. Je n'ai presque pas eu besoin de poncer avant de passer une deuxième couche d'enduit (principalement destiné à masquer le grain grossier du plâtre). Un coup de peinture appliquée avec une brosse à encoller les papiers peints, bien chargée de peinture pour laisser volontairement des marques de pinceau (qui évitent l'effet miroir qui rend visibles les défauts de planéité), et le résultat n'est absolument pas choquant.
On notera que la vraie solution pour les plafonds hourdis consiste à:

- insérer des lamelles de ferraille
entre les hourdis. Ces lamelles spéciales sont crantées
pour s'ancrer dans la fente entre les parpaings.
- visser une
tige filetée sur chaque lamelle,
- éventuellement,
embrocher de l'isolant sur les tiges
- visser une plaquette au
profil fait-pour sur la tige filetée
- mettre toutes les
plaquettes de niveau en les vissant plus ou moins
- clipser des
rails métalliques sur les plaquettes
- fixer les plaques
de plâtre sous les rails avec des vis.
Cette solution
n'est pas si dispendieuse, et l'absence de tout collage la rend
assez rapide. Consultez votre vendeur de matériaux.
Pour ma salle de bain qui a reçu un nouveau plafond, le maçon s'est gouré de plusieurs centimètres sur les cotes, et je ne disposais plus de l'espace sous plafond nécessaire pour la solution précédente. J'ai aussi utilisé une méthode où j'ai d'abord collé des plaques de polystyrène 2cm, puis enduit le tout avec une couche relativement fine de la même colle à polystyrène (plus résistant et lisse que le plâtre). Les plaques servent évidemment d'isolation, mais aussi de lissage des marques entre hourdis (et des différences de niveaux entre les hourdis). Cette solution est quelque part plus facile que la première, puisque l'on enduit quelque chose de relativement plus plat, mais cela reste relativement fragile: Cécile à réussi a faire un "poc" en laissant échapper un chouchou élastique muni d'une bille en bois. L'impact aurait surement été moins profond avec une vrai plaque de placo, mais hisser et coller ces plaques demande un lève-plaque, et la manipulation tout seul de celles-ci est vraiment galère. Peut-être que la bonne solution serait de coller un tissus de verre sur le polystyrène, ce qui aurait formé une peau bien plus résistante?